 |
| Retour vers la page d'accueil | |||
| AMOUR DE LA PROVENCE, AMOUR DU MONDE | |||
Il y a donc, chez le poète, une façon assez paradoxale de se situer dans le monde. Le 4 avril 1923, dressant le bilan de son service militaire, il note à la fois son " épuisement de la faculté de languir " et un surprenant : " Je reviens plus mondial que jamais. " En 1931, quand il aura connu l'exil des postes dans les pays les plus lointains, Sydney, Nouméa, il refusera que l'on qualifie sa poésie de poésie d'évasion. Au contraire, soutient-il, " c'est une poésie d'hommes du monde, d'hommes chez eux partout dans le monde, d'hommes vivants, mais qui certainement ne se fuient pas " (3 juillet). Toute sa vie, Louis Brauquier revendiquera ainsi son universalisme. Lui qui a passé tant d'années loin de sa Provence, comment pourrait-il ne pas être " mondial " ? Mais comment expliquer dès lors son refus du Nord, que l'on retrouve plus tard dans ses diatribes contre le climat atmosphérique et moral de Paris comme dans les plaisanteries qu'il adresse à Audisio quand celui-ci est invité à faire des conférences dans les pays scandinaves ?
" Cent mètres de la rue Beauvau... " C'est que, pour Louis Brauquier, le monde n'est pas celui de n'importe quelle carte, où tous les pays du monde seraient à égalité. Il est ce qu'on atteint par mer à partir du port de Marseille. Tel est le sens, dans " Rue maritime ", de son célèbre : " Cent mètres de la rue Beauvau, comme vous possédez le monde ! ", ou plutôt selon la première version du texte, plus significative parce qu'elle marque l'extension depuis Marseille : " Comme vous grandissez le monde ! " L'unité du globe est perçue à travers les liaisons maritimes, dans les lignes tracées sur les cartes marines : Où tous les ports de la terre Sont rejoints par des traits rouges Avec le nombre des jours. 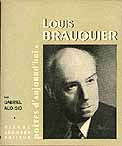 |
|||
| Louis Brauquier par Roger Duchêne |  |